Une scène particulière nous retient, puisqu’elle présente encore une nouvelle typologie de l’assise - et donc d’être-au-monde. Là sont réunis le narrateur et la Duchesse sur le même siège, une bergère. Nous devinons que la réunion des deux personnages sur la même assise n’est pas anodine : elle marque le moment où, le narrateur ayant cessé d’être amoureux de Mme de Guermantes, il cesse de la poursuivre et devient alors intéressant pour elle.
Les chaises, ici, se situent encore une fois au centre d’un dispositif qui constitue l’exact inverse de l’organisation spatiale de la première réception chez Mme. de Villeparisis. Dans cette scène, Saint-Loup œuvre difficilement pour placer son ami (le narrateur) auprès de Mme de Guermantes : « “Tiens, je vais un peu près de ma mère, je te donne ma chaise”, me dit Saint-Loup en me forçant ainsi à m’asseoir à côté de sa tante » [1]. Malgré ce savant jeu de chaises musicales, l’ordre mondain reste immuable.
C’est d’ailleurs un motif constant que cette volonté de Saint-Loup de donner une meilleure place (dans les deux sens du terme, puisqu’ils sont presque une seule et même chose) au narrateur : dans le restaurant où il le rejoint, il le trouve à sa grande surprise assis à côté d’une porte et de ses courants d’air et s’empresse de demander au maître d’hôtel une meilleure place [2].
Mais si une mauvaise chaise est souvent cruellement symbolique d’une mauvaise place dans le monde, obtenir une meilleure chaise (ici, par l’entremise de Saint-Loup) n’est pas forcément synonyme de succès.
Si Saint-Loup n’a pas le pouvoir nécessaire pour donner une nouvelle place au narrateur, il fait tout de même partie de cette classe à laquelle le mobilier n’oppose pas de résistance ; d’où cette scène surréaliste dans le restaurant, physiquement inconcevable, où Saint-Loup saute prestement par-dessus les obstacles pour parvenir à sa table « [...] quand Saint-Loup, ayant à passer derrière ses amis, grimpa sur le rebord du dossier et s’y avança en équilibre, des applaudissements discrets éclatèrent dans le fond de la salle » [3]. Seule Mme de Guermantes, néanmoins, peut offrir une place au narrateur ; c’est ainsi que, dans la deuxième réception chez Mme de Villeparisis, elle le rejoint sur une bergère, un fauteuil qui n’est conçu que pour deux, « en relevant gracieusement son immense jupe qui sans cela eût occupé la bergère dans son entier » [4]. Nous pensons ici à l’approche du mobilier par Mario Praz (Une philosophie de l’ameublement), qui note un « rapport de conformité entre l’ameublement et l’habillement féminin » [5].
Mais ici cette conformité, qui éclaire sous un angle différent l’aspect « contaminant » des corps envers le mobilier, engendre presque une concurrence. Mme de Guermantes, qui approche justement le narrateur pour l’inviter à dîner, le rejoint sur son assise pour laquelle elle est trop grande, trop large, hors échelle presque (« Plus grande que moi et accrue encore du volume de sa robe » [6]).
Une sorte de renversement s’opère, cette fois dans l’ordre de grandeur du vêtement et du mobilier, de sorte que le narrateur semble davantage assis sur la robe de la Guermantes que sur la bergère déjà avalée par la présence de la Duchesse.
Si ce premier niveau renseigne une fois de plus sur le régime des corps (cette fois associé au vêtement), il ne s’agit pas uniquement d’un mode métaphorique. Ainsi la scène apparemment anodine de la bergère crée un malentendu et fait croire aux invités voyant la duchesse et le narrateur « sur un meuble si étroit qu’on n’y pouvait tenir que deux » [7] à un adultère, dont ils font aussitôt courir la rumeur.
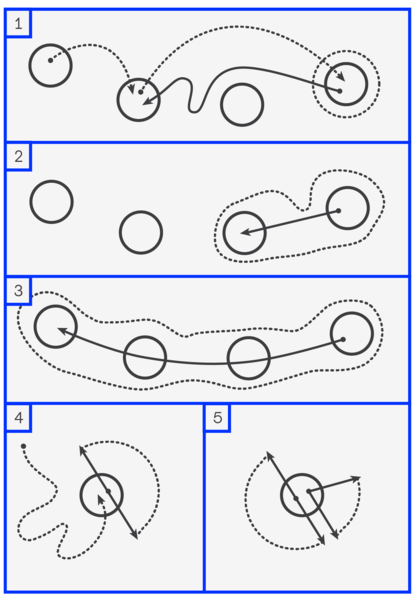
Malgré le cocasse de la situation, Mme de Guermantes continue de constituer le noyau d’influence de son salon. Elle porte avec elle cette aura, qui comme sa robe, absorbe tout ce qu’elle touche, y compris le narrateur qui, rapproché incidemment de la duchesse (« effleuré par son admirable bras nu ») est tout de suite inclus au rang de ses possessions. Nous retrouvons cette indissociabilité du corps et du décor commentée par Mario Praz et Julien Gracq, sur un mode similaire [8] ; ce dernier parle du Baron de Charlus qui « se soude plutôt au détail de chaque scène du livre et semble s’absorber en elles, comme ces personnages, dans les décors des bibliothèques qu’a peint Vuillard, qui sont comme maçonnés dans le mur de livres auquel ils s’adossent » [9] (qui nous rappelle le meuble-coquille peint par Schwingen).
Ainsi le narrateur est intégré à cette « matière Guermantes » dans une scène révélatrice, qui sera suivie de l’invitation à dîner tant attendue. Mais pour parvenir à cette fin, la duchesse abandonne un peu de son omnipotence et dans sa position (aussi absurde en un sens que les sauts de cabri de Saint-Loup au restaurant), elle se retrouve presque piégée : « N’ayant guère de place, elle ne pouvait se tourner facilement vers moi et, obligée de regarder plutôt devant elle que de mon côté, prenait une expression rêveuse et douce, comme dans un portrait » [10]. Dans ce moment très curieux, Mme de Guermantes reste maîtresse de la situation, grâce à son assise sur la bergère ; si la Duchesse semble créer une situation inconvenante, elle garde en effet la distance la plus importante, celle de son regard, qu’elle fait sans cesse échapper à ceux qui ne semblent pas le mériter : ainsi dans la première réception chez Mme de Villeparisis, pour ne pas dire au revoir à Bloch, elle met en œuvre tout un jeu, entre un prétendu endormissement et des « regards noyés » (« elle se contenta d’abaisser les paupières et de fermer les yeux » [11]).
Il y a toujours, pour les Guermantes, une compensation dans un système complexe unissant assise, regard et parole ; l’un compense toujours les faiblesses de l’autre (ici, le regard compense la faiblesse du corps, qui en dit trop sur les intentions de la duchesse, et même plus qu’il n’y a à comprendre). Mais ce contrôle n’est pas toujours optimal et dans ce domaine les Guermantes font figure d’exception.

